Censure de la loi renseignement : la fin d’un vide juridique datant de 25 ans
- Guillaume Schmidt
- 2 nov. 2016
- 3 min de lecture

« Il s’agit d’une victoire pour les libertés numériques » déclarait l’avocat Patrice Spinosi à l’occasion de la censure le vendredi 21 octobre de l’article L811-5 de la loi renseignement relatif aux surveillances numériques.
Un vide juridique inquiétant:
Celui-ci, en vigueur depuis la loi sur les écoutes de 1991 et renommé ainsi lors de la loi renseignement du 5 mai 2016, énonçait: « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ». Il en résultait que les services de renseignement pouvaient surveiller des communications entre particuliers via téléphone portable, wifi, ou bluetooth, en contournant les contrôles que cette loi imposait: L’avis de la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR) était ainsi requis, avant l’autorisation par le Premier ministre, pour la surveillance de particuliers. Cet article permettait notamment de contourner le code de procédure pénale qui encadre les écoutes ordonnées par un juge d’instruction.
Le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la loi renseignement en juillet 2015 en censurant deux dispositions, sur saisine, en application de l’article 61 de la Constitution, du Président de la République et du Président du Sénat. Il n’avait alors validé que les articles présentés dans ces saisines et n’avait pas statué sur ce sujet.
Mais le 6 mai, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat et sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité concernant cette disposition était déposée par un groupe surnommé « les exégètes amateurs », composé de l’association de défense des libertés numériques La Quadrature du Net, du fournisseur d’accès (FAI) associatif French Data Network et de la Fédération des FAI associatifs. Leur avocat, Maître Patrice Spinosi, affirmait que l’article, permettant une surveillance sans le moindre contrôle, avait crée « un trou législatif béant » et ouvert la voie à un « espionnage de masse ».
Une atteinte au respect de la vie privée
Les « Sages » du Palais Royal affirment que la disposition législative attaquée est contraire à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en portant « une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ».
Selon la décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, ils déclarent tout d’abord qu’en permettant des surveillances de communications « sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables » l’article porte atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel affirme que cet article n’interdit pas des mesures de surveillance à des fins plus larges que la seule défense des intérêts nationaux évoquée dans le texte. Enfin il est précisé que la disposition ne précise en aucune façon la nature des surveillances effectuées, que par conséquent elles ne sont accompagnées d’aucune condition de fond ou de procédure et ne sont encadrées par aucune garantie de mise en oeuvre. L’article 811-5 du code de la sécurité intérieure est donc déclaré contraire à la Constitution.
Une censure à effet différé.
Cependant pour ne pas empêcher les services de renseignement de procéder à des écoutes au nom de la défense des intérêts nationaux, le Conseil censure, mais de manière différée, l’article L811 du code de la sécurité intérieure, car son abrogation immédiate « aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne » et « entraînerait des conséquences manifestement excessives ».
Il reporte donc au 31 décembre 2017 l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 62 de la Constitution alinéa 2 qui dispose qu’une disposition entachée d’inconstitutionnalité par le Conseil Constitutionnel « est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ». Le Conseil constitutionnel détermine en outre « les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». Ainsi les sages décident que jusqu’à la date fixée, aucune mesure de surveillance ne peut être autorisée par les dispositions de l’article et que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement doit régulièrement être informée des mesures prises en application de cet article.
A la nouvelle législature qui sortira des urnes en juin 2017 de faire le tri parmi les surveillances entre ce qui relève d’atteintes à la vie privée ou non.
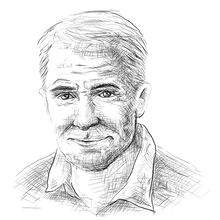



Commentaires