La victoire du droit des femmes à disposer de leurs droits fondamentaux : Les polonaises contre le
- Edouard Papeil
- 28 oct. 2016
- 4 min de lecture

Le développement des droits de l’Homme à l’échelle nationale et internationale a été fulgurant depuis la fin d’une des plus grande tragédie qu’a connu l’Europe, la Seconde Guerre Mondiale. Dès lors il était inévitable que ce mouvement s’accompagne d’une égalisation des droits entre les hommes et les femmes, ces dernières ne cessant de repousser les barrières sociales et juridiques s’imposant à elles.
Droits inhérents aux femmes
Aujourd’hui il est courant d’entendre parler de « Droits de la femme », expression très utilisée par les associations qualifiées de « féministe ». L’utilisation de ce terme peut paraitre critiquable, en ce sens qu’il pourrait laisser supposer que les droits dont les femmes peuvent se prévaloir seraient différents des droits des hommes. Cependant, il reflète la nécessité d’assurer l’égalité politique, juridique, civile, entre tous les citoyens, quelques soit leur sexe. D’ailleurs ce principe a valeur constitutionnelle, puisqu’il est inscrit en l’article premier dans le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Mais la nature a posé des différences entre les sexes, supposant que certains droits soient reconnus spécifiquement aux femmes, afin que ces divergences biologiques n’entrainent pas d’inégalité ou de discrimination.
La grossesse est la plus représentative de ces différences, puisqu’autour d’elle gravite un nombre d’enjeux non négligeables, sur lesquels il est impératif de s’interroger. En effet si il existe encore en occident où la religion chrétienne a jusqu’au 18ème siècle a eu une place prédominante, l’idée selon laquelle le fait d’avoir un enfant est un « cadeau », ce moralisme très largement dépassé.
Mais à la question : les femmes ont ils le droit de l’interrompre ? Seules deux réponses sont possibles. Non, attendre un enfant, ne doit pas et ne peut pas être sacralisé. Oui, il existe un droit pour les femmes d’interrompre cette venue au stade embryonnaire de la grossesse (Le délais légale, en France, est fixé à douze semaines maximum). Pourquoi ? Parce qu’il arrive à tous de faire des erreurs, parce que cela peut être handicapant pour une femme carriériste, parce que ça peut être le résultat d’un viol… mais surtout parce que chacun doit avoir la liberté de disposer de son corps.
La reconnaissance travestit du droit à l’avortement par le Parlement Polonais
En France, les dames sont à l’abri en ce qui concerne leur droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui leur a été reconnu par une loi de 1975, portée par Simone Veil, qui était alors l’une des seules députés avec un « e », et qui a combattue un Parlement composé à majorité d’hommes, qui n’étaient pas prédisposés à Gauche comme à Droite a se saisir du sujet. Depuis de nombreux reportages ont rendu compte de la nécessité de ce progrès social et juridique qu’est le droit à l’avortement. Mais cela n’empêche pas certains membre du parti FN (Front national) de le remettre en cause d’une manière ou d’une autre…
En Pologne, la situation est différente. Déjà parce que la loi concernant l’avortement, dans ce pays à forte tradition catholique, ne fût voté qu’en 1993, ce qui est tardif. Mais aussi parce qu’il se limite qu’à trois hypothèses :
grossesse résultant d'un acte illégal
risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte
malformation grave du fœtus.
L’hypothèse d’une jeune femme de 16 ou 17 ans rentrant au lycée, ne prenant pas la pilule, mais dont les moyens de contraception auraient été défectueux, est dès lors exclue, peu importe que sa vie et celle de son compagnon soit gâchée par la venue de cette enfant. A l’Est, sévit une discrimination entre les femmes, qui selon leur situation, qu’elle soit « fautive » ou non, se voit reconnaitre le droit d’avorter. En sens ce l’état du droit positif est critiquable juridiquement, d’ailleurs la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a condamné la Pologne de nombreuses fois à ce sujet, mais aussi moralement, et la situation doit évoluer.
La méconnaissance du droit à l’avortement par le Parlement polonais
Les statistiques pourtant parlent d’elles-même, puisque seulement 669 avortements légaux ont eu lieu en Pologne en 2011, alors que l’organisation, Federa (militante du droit à l’avortement) estime que chaque année entre 80 000 et 100 000 femmes polonaises choisissent de mettre un terme à leur grossesse. Malgré ces chiffres parlant, la requête de la CEDH faite à l’Etat Polonais d’assurer « l’effectivité du droit à l’avortement » dès lors qu’il est reconnu (Décision du 30 Octobre 2012), le Parlement polonais, décide de faire marche arrière. Ainsi, en 2016, a été déposé le 23 septembre 2016, un projet de loi, disposant que toute femme qui avorterait ou toute personne qui pratiquerait un avortement (médecin, infirmier) serait passible d’une peine de cinq ans de prison … quelle honte !
Mais les polonaises ont fait preuves de bravoure, de courage, en s’organisant efficacement afin de mettre fin à cette folie. En réaction au projet de loi, le lundi 3 octobre à Varsovie, toutes vêtues de noire, près de 100 000 femmes se sont réunies, pour faire entendre leur voie, et celle d’une majeur partie de la population (selon les études statistiques, plus de la moitié de la population serait en faveur d’un élargissement du droit à l’avortement, ou du moins pur un maintient de la loi actuelle). Ce mouvement pacifique, n’est pas passé inaperçue à l’échelle nationale, et auprès d’une population qui, encore marquée par le régime communiste se veut peu contestataire, ce que souligne la sociologue Miroslawa Grabowska, présidente de l’institut de sondage CBOS. Cependant des organisations « pro-vie » ont en parallèle des contre-manifestations « blanches » à travers le pays et des appels à la prière.
Il semble pourtant que les députés polonais n’aient pas céder à la tentation de l’éternel retour en arrière. Ainsi ils ont rejeté le texte, le Jeudi 6 Octobre, alors que déjà la commission de la justice et des droits humains de la chambre basse avait rejeté la proposition de loi déposée par le chef de la majorité ultraconservatrice de W. Czarnecki.
La question d’une loi plus souple se pose désormais en Pologne, mais aussi aux polonais, qui on l’espère, comprendront un jour en leurs corps et âmes qu’il est nécéssaire, par la loi, de « répondre au désir, conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d’angoisse » (S. Veil).
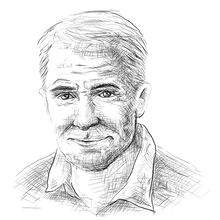
Comentarios