Jacques Vergès : le paradoxe de « l’avocat de la terreur » et de l’humanisme
- Julia Pelfrêne
- 11 oct. 2016
- 8 min de lecture

Une jeunesse déterminante pour une vie mouvementée
Issu de l’union d’une institutrice vietnamienne et de Raymond Vergès, docteur et consul de France, Jacques Vergès naît le 5 mars 1925 au Siam, l’actuelle Thaïlande. Orphelin de mère à l’âge de 3 ans, son père d’origine réunionnaise l’emmène vivre à la Réunion avec son frère Paul, où ils sont élevés par leur tante. Il obtient son baccalauréat à l’âge de 16 ans et valide sa première année de droit l’année suivante. Résistant de la première heure, il s’engage dans les Forces Françaises Libres alors qu’il est seulement âgé de 17 ans.
Les combats de sa vie : le communisme et l’anticolonialisme
Jacques Vergès s’initie très tôt à la politique, et plus exactement à l’âge de 12 ans, lorsqu’il participe à un grand défilé du Front Populaire avec son frère. Au cours de sa jeunesse, il rencontre de futurs dirigeants, relations qu’il conservera plus tard, se liant même parfois d’amitié avec quelques uns. A la fin de la guerre, en 1945, il adhère au Parti Communiste Français (PCF). Bien que célèbre pour ses convictions communistes, il conserve de son engagement dans la Résistance un profond attachement à la personne du Général de Gaulle à tel point que certains parlent de « gaullo-communisme » pour qualifier son idéologie politique. Il quitte le PCF en 1957 car il juge le parti « trop tiède » sur la question de l’indépendance algérienne. Suite à sa rencontre avec Mao Zedong en 1963, il se rattache aux thèses maoïstes. Ce ralliement ne plaît guère à tout le monde puisqu’il conduit à sa destitution de son poste de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères algérien et le contraint à rentrer à Paris. Là, il crée le premier journal maoïste de France : Revue. Progressivement, à force de participations aux réunions et de côtoyer les hautes sphères du communisme, il fait la connaissance de futurs Khmers rouges et notamment de Pol Pot.
De sa naissance au Siam, il garde un souvenir du poids du fait colonial qui fut certainement à l’origine des prises de position anticolonialistes prises au cours de sa longue vie. Elles commencent par celle en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Se qualifiant lui-même de « petit agitateur anti-colonialiste du Quartier latin », il milite pour le Front de Libération Nationale et se charge de la défense juridique de ses combattants. C’est au cours de cette occupation qu’il rencontre son épouse. Toute sa vie, il fustigea la politique étrangère de la France.
Après l’Algérie, il se penche sur la question israëlienne et se prononce en faveur de la cause palestinienne.
L’Algérie : son grand amour
Suite l’indépendance de l’Algérie en 1962, il s’installe à Alger et prend la nationalité algérienne. Il devient le chef de cabinet du ministre des affaires étrangères algérien. Peut être est-ce son amour et sa dévotion pour ce pays qui le convertissent à l’islam.En raison de sa destitution de la fonction de chef de cabinet et son départ obligé pour la France, il doit attendre la propre déchéance du Président Ben Bella pour revenir en Algérie.
Par ailleurs, il épouse l’indépendantiste algérienne et ancienne cliente Djamila Bouhired en 1965, avec laquelle il eut deux fils le temps que dura leur union. La plupart des aspects privés et des évènements marquants de sa vie le ramènent invariablement vers l’Algérie, telle une terre d’adoption.
Avocat par défaut, néanmoins ténor par talent
Après l’obtention de sa troisième année de droit et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), il prête serment en 1955 et s’inscrit au barreau de Paris.
Lorsqu’on regarde la tournure et l’ampleur de sa carrière, qu’elle n’est pas la surprise quand on apprend que le droit est en réalité une voie que le grand avocat a pris par défaut car, selon ses propres mots, « agitateur public ne fait pas une vie ». Il s’explique : « le droit n’était pas ma vocation, j’ai étudié l’histoire et les langues, mais je me suis dit qu’avec ce métier je serai libre ». Pourtant, il s’avère être doué, talentueux même. Un ténor du barreau en somme puisque c’est un orateur d’exception en plus d’être un expert en procédure. Son nom est à jamais gravé dans l’histoire du barreau français : d’une part en raison de la liste prestigieuse et critiquable de ses clients et d’autre part, parce-qu’il est l’initiateur d’une stratégie de défense révélatrice de son génie et qui contribua amplement à sa célébrité. Les détracteurs et les admirateurs de Jacques Vergès s’accordent sur un point : l’avocat a fondé sa notoriété sur le fait de défendre des « salauds ». En effet, par « liste prestigieuse et critiquable de clients », il faut comprendre que le plaideur a assuré la défense de personnes condamnées par l’Histoire ou ayant commis des crimes particulièrement graves. Les plus connues sont le nazi Klaus Barbie, le terroriste révolutionnaire vénézuélien Carlos et l’ancien dirigeant cambodgien Kieu Samphân. Ce type de clientèle qui lui vaut le surnom d’« avocat de la terreur ». Pour Vergès, la défense de ses personnes relève du défi, mais surtout du devoir. Il l’assume volontiers, tel que le démontrent ses propres paroles « plus l’accusation est lourde, plus le devoir de défendre est grand, comme un médecin doit soigner tout le monde ». Il n’en reste pas moins réaliste avec une note de brio : « Serais-je prêt à défendre Hitler ? Bien sûr ! Et même Georges W. Bush. Je suis prêt à défendre tout le monde à condition qu’ils plaident coupables ». Il fallait oser le dire. Jacques Vergès doit également son prestige à la stratégie ingénieuse et audacieuse dont il est l’élaborateur : la « rupture défensive ». Le principe est que l’accusé devienne accusateur : au lieu de chercher à minimiser les faits reprochés et à obtenir l’indulgence des juges, l’avocat interpelle l’opinion, la prend à témoin et pointe du doigt de manière plus ou moins virulente le système ainsi que ses institutions. Cette stratégie lui permet de sauver la vie de plusieurs personnes condamnées à mort pendant la guerre d’Algérie.
Sur tous les innombrables procès dans lesquels il a plaidé, six sont présentés ici afin d’illustrer au mieux le talent de ce ténor du barreau :
L’indépendantiste algérienne Djamila Bouhired (1957) : la jeune militante du FLN était une poseuse de bombes meurtrières durant la guerre d’Algérie. Elle fut torturée, jugée puis condamnée à mort. Vergès mena une campagne médiatique importante et publia un manifeste qui menèrent à sa grâce. Cette défense lui vaut une suspension du barreau pendant un an ainsi qu’une tentative d’assassinat.
Le nazi et ancien chef de la Gestapo Klaus Barbie à Lyon (1987) : Klaus Barbie est un des plus grands criminels nazis et notamment le bourreau du célèbre résistant Jean Moulin, mort sous la torture. Dans ce procès, Jacques Vergès utilise sa stratégie de rupture défensive en inversant l’accusation. Il reproche aux accusateurs d’avoir fait la même chose que Barbie durant les guerres de décolonisation, à savoir l’usage de la torture lors des interrogatoires des indépendantistes algériens. Il met en avant le poids ainsi que la rigidité de la hiérarchie nazie pour expliquer les exactions et les crimes de son client.
Le jardinier Omar Raddad (1994) : le jardinier était accusé d’avoir assassiné sa patronne en raison d’une inscription « Omar m’a tué ». Vergès met une fois de plus sa fameuse stratégie à son service en comparant l’affaire à celle de l’affaire Dreyfus : « Il y a cent ans, on condamnait un officier parce qu’il avait le tort d’être juif. Aujourd’hui, on condamne un jardinier parce qu’il a le tort d’être maghrébin ». Il dénonce le racisme anti-arabe qui sévit en France et érige son client en symbole de l’erreur judiciaire. L’accusé est finalement gracié par Jacques Chirac en 1996.
Le terroriste vénézuélien Carlos (1994) : ce denier était jugé pour la fusillade du 25 juin 1975 à Paris au cours de laquelle deux inspecteurs de la Direction de Surveillance du Territoire furent tués. Cependant, Jacques Vergès se retire de l’affaire par stratégie, car la justice s’intéressait aux liens de l’avocat avec l’organisation terroriste de l’accusé, en raison de son idéologie communiste connue. L’amitié de ce dernier avec Che Guevara ne l’aide certainement pas à réfuter l’hypothèse de ses liens avec le réseau terroriste.
Le terroriste Georges Ibrahim Abdallah (2007) : le terroriste libanais membre du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) était incarcéré depuis 26 ans pour l’assassinat en 1982 d’un diplomate israëlien et d’un attaché militaire américain. Jacques Vergès le défend sans doute en raison de leur convergence idéologique sur la question palestinienne. Dans sa plaidoirie, il dénonce la volonté revancharde post-11-septembre des Américains et critique de manière virulente la lutte anti-terroriste menée par Georges Bush en la stigmatisant, de même que les méthodes appliquées pour sa mise en œuvre.
L’ancien dirigeant Khmer rouge Kieu Samphân (2008) : l’ancien dirigeant cambodgien était poursuivi pour crime contre l’humanité. L’avocat l’a rencontré dans les cercles marxistes anticolonialistes qu’il fréquentait.
1970-1978 : une disparition passée sous silence
Durant cette période, Jacques Vergès disparaît de la circulation et de tout autre radar. Il demeure introuvable. Est-il mort ? Non, puisque sa famille fait savoir à son éditeur qu’il est en bonne santé. C’est l’unique nouvelle de sa bien portance au cours de ces années silencieuses. Des avis de recherches sont publiés bien qu’ils n’aboutissent à aucune réponse.
Mais où est donc l’avocat ? Pourquoi est-il parti ? A son retour, ces questions lui sont posées sans qu’il y réponde ou quand il le fait, il reste évasif. On sait que cette disparition mystérieuse et inexpliquée fut ponctuée par des retours clandestins dans la capitale française. Quant à l’interrogation sur la destination de ses « vacances », il répond « très à l’Est de la France ». Les hypothèses diverses, variées et rocambolesques fusent : Liban, Moscou ou travail pour les Khmers rouges chez Pol Pot au Cambodge. Certains vont jusqu’à penser qu’il se serait exilé pour sauver sa vie car le Mossad, les services secrets israëliens, est à ses trousses en raison de sa prise de position en faveur des Palestiniens dans le conflit . L’hypothèse la plus rationnelle serait qu’il aurait fui les problèmes financiers. Or à son retour, il revient fortuné, sans que quiconque ne sache quoique ce soit sur la provenance de cet argent.
Comme chaque grand homme a ses mystères, celui de Jacques Vergès réside en la passation sous silence de cette période.
Le dernier prétoire
Vers la fin de sa vie, l’avocat se lance dans le théâtre où il interprète parfois son propre rôle et également dans l’écriture.
Jacques Vergès décède d’une crise cardiaque le 15 août 2013 à Paris, dans la même chambre où Voltaire a lui-même trépassé. Il fallait une ultime coïncidence pour rappeler à quel point l’avocat « lumineux » disposait d’une verve inégalable, comme le philosophe des Lumières.
A l’annonce de sa mort, le chroniqueur Stéphane Durant-Souffland a publié sur Twitter : « c’est la deuxième fois que Vergès disparaît et il ne nous dira pas où il est ». Le ténor a emporté son secret dans son dernier prétoire : son tombeau.
L’existence de Jacques Vergès est une succession de paradoxes. Communiste, il adule de Gaulle. De même, il aime l’Algérie alors que la politique étrangère du Général en Afrique est critiquable. Ancien résistant, il défend celui qui aurait pu le torturer dans une autre vie. Imprégné des valeurs anticolonialistes qui ont vocation à lutter pour l’autodétermination des peuples, leur droit à disposer d’eux-mêmes, néanmoins il défend d’anciens dictateurs. Parce-qu’il assure la défense de grands criminels, on peut lui reprocher son inhumanité. Mais ce qu’il est avant tout essentiel d’avoir en tête pour comprendre cet homme complexe au destin hors du commun, qui se qualifie lui-même de « salaud lumineux », c’est qu’il est un grand humaniste au sens des Lumières, quoique que nous puissions dire et quoiqu’il ait pu dire lui-même de son vivant. En effet, rappelons-nous qu’en France et ce depuis 1789, chaque homme a le droit à une défense correcte, condition sine qua none à un jugement équitable, quelque soit le crime perpétré. Cela, Jacques Vergès le savait très bien. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il se faisait un devoir de défendre ceux qui ont bafoué les valeurs des Droits de l’Homme mais également ceux qui en ont fait une religion telle qu’ils ont commis des actes condamnables. A noter que dans la plaidoirie où il défend Barbie, aucun de ses arguments n’est révisionniste. Cependant, comme tous les génies, il demeure un souvent incompris. Celui qui disait « les poseurs de bombes sont des poseurs de questions » avait en réalité tout déchiffrer de la nature humaine et de ses aspirations. A ce titre, Jacques Vergès mérite un hommage, aussi humble soit-il ici.
SOURCES : www.wikipédia.fr; www.franceinter.fr; www.lepoint.fr; www.avocatsemotionsetdilemmes.fr; www.rue89.nouvelobs.com ; Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron ; Avocats : Le Verbe et la Robe ; La parole est à l’avocat d’Olivier Duhamel et Jean Veil
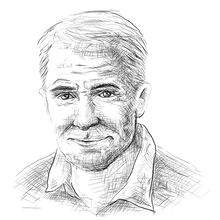



Commentaires